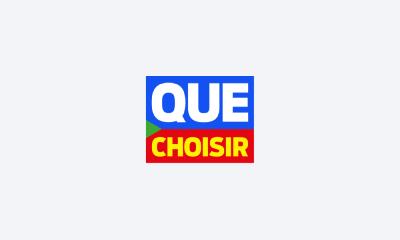Contrats obsèquesUn encadrement strict s’impose pour mettre fin aux dérives
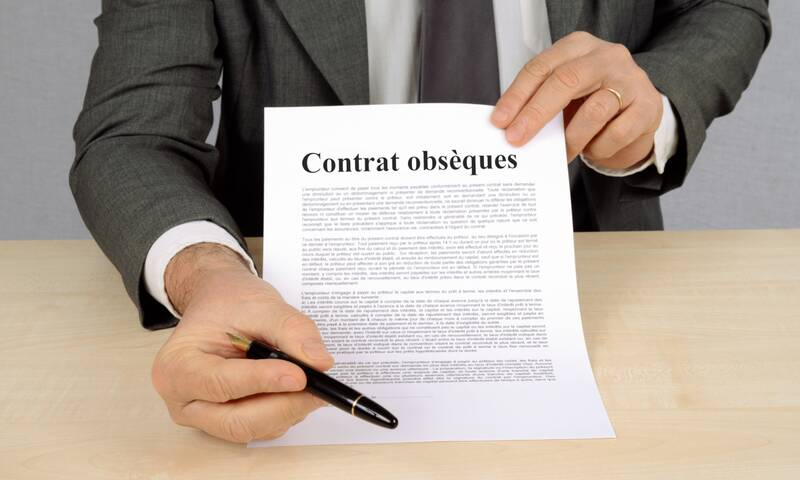
À l’approche de la Toussaint, l’UFC-Que Choisir et l’Unaf alertent sur les dérives du marché des contrats obsèques. Trop de consommateurs ayant souscrit un contrat obsèques à cotisation viagère, finissent par verser des montants bien supérieurs au capital garanti, faute d’informations claires. Sur un marché en forte croissance, les marges dégagées par les assurances sur ces produits atteignent des niveaux particulièrement indécents.
Les deux associations appellent à un encadrement légal des cotisations et à une meilleure information des familles.
Un pactole sur la mort pour les assureurs
Aujourd’hui, 32 % des décès sont couverts par un contrat d’assurances obsèques. Pour les assureurs, ce produit s’avère particulièrement rentable : 1,8 milliard d’euros de cotisations sont collectés chaque année, mais seuls 40 % de ces montants sont reversés aux familles endeuillées.
Ce déséquilibre manifeste, au détriment des familles, s’explique notamment par les contrats à cotisations viagères. L’absence de plafond des cotisations conduit à des situations intolérables : des assurés versent parfois le double du capital garanti, tandis que les valeurs de rachat des contrats très faibles, les contraignent à accepter de poursuivre le processus de surcotisation jusqu’à leur mort.
Le devoir de conseil mis à mal par les pratiques commerciales du secteur privé
Documents peu lisibles, explications incomplètes sur la logique “assurance” (et non épargne), valeurs de rachat peu claires, durée viagère ou délai de carence mal expliqué : le devoir de conseil des distributeurs est gravement défaillant.
De plus, l’identification et l’activation des garanties prévues au contrat, au moment du décès, demeurent trop complexes, obligeant souvent les familles à avancer les frais avant que le capital ne soit mobilisé.
Beaucoup de consommateurs ignorent également les solutions alternatives existantes : possibilité de faire régler directement la facture par la banque du défunt des frais dans la limite légale de 5 910 €, sans avance de frais, y compris en prélevant sur plusieurs comptes si nécessaire, ou recours à des prestations sociales (prestations de sécurité sociale, capital décès des fonctionnaires, prévoyance d’entreprise).
La priorité des assureurs et des opérateurs funéraires reste la vente de prestations funéraires ou des contrats obsèques, souvent au détriment des besoins des familles.
Ce que disent les régulateurs et la place
Le superviseur (ACPR) a déjà pointé des manquements récurrents au devoir d’information et de conseil lors d’opérations de contrôle. De son côté, le CCSF a adopté en 2024 plusieurs avancées utiles pour améliorer la transparence de ces contrats : tableaux standardisés présentant le coût total selon l’âge et le mode de paiement, visibilité accrue des valeurs de rachat, encadrement des exclusions et réduction du délai de carence à douze mois. Des progrès utiles, mais qui ne traitent pas le cœur du problème : la rentabilité excessive des contrats obsèques et l’absence de cadre légal sur le montant des cotisations.
En effet, aucune disposition du code des assurances ou du Code civil ne permet aujourd’hui d’encadrer le risque de surcotisation indue. Pour l’UFC-Que Choisir et l’Unaf, il est donc urgent que le législateur intervienne pour plafonner les cotisations et protéger les familles.
Ce que nous demandons
- Au Législateur : plafonner le cumul des cotisations viagères à deux fois le capital garanti et obliger l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (Agira) à prévenir dans un délai de 24 heures l’opérateur funéraire bénéficiaire du contrat ou dans un délai de 48 heures le proche désigné.
- À l’ACPR : recenser le nombre de contrats obsèques en déshérence entre 2022-2025, avec le non-versement du capital notamment en raison de clauses bénéficiaires mal rédigées.
- Au Ministère de l’Intérieur et à l’Association des maires de France : intégrer l’Agira à la liste des organismes informés d’un décès par les communes, afin de faciliter l’identification rapide des bénéficiaires et mettre à disposition, dans les communes, des supports d’information standardisés (prestations obligatoires ou facultatives, moyens alternatifs de financement).
Lire aussi