
par Elsa Casalegno

par Elsa Casalegno

Des quotas de pêche de plusieurs dizaines de tonnes de civelles (la phase juvénile de l’anguille) sont accordés chaque année par la France aux pêcheurs, alors que ce poisson est en danger critique d’extinction. Une consultation publique est en cours jusqu’au 24 octobre.
Le point commun entre l’orang-outang, le rhinocéros de Java et l’anguille européenne ? Ces trois espèces sont classées en « danger critique d’extinction » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) depuis 2008. Les scientifiques préconisent donc un arrêt total de la pêche de l’anguille, et en particulier de la civelle, sa phase juvénile.
Dans une conférence de presse, le 20 octobre, les représentants de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), d’Ethic Ocean et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques (FNPF) appellent donc l’État à décréter un moratoire sur la pêche à l’anguille et à la civelle, afin de permettre le rétablissement de l’espèce. Ils ont rappelé que « les populations de ce poisson se sont effondrées de plus de 90 % depuis les années 1980, et même de 99 % depuis les années 1960 ». Et la pêche est la principale cause de cet effondrement.
Cette pêche est déjà encadrée par un règlement européen datant de 2007. Ce texte impose un plan de gestion aux États membres, dans l’objectif de reconstituer les stocks d’anguilles, en particulier en établissant des quotas de capture pour la pêche professionnelle uniquement (la pêche est interdite aux amateurs). L’État n’a pas voulu aller à l’encontre des pêcheurs, et la France reste l’un des seuls pays autorisant encore la pêche à la civelle, pesant 90 % des volumes pêchés au niveau mondial. Résultat, 10 ans après leur lancement, ces plans de gestion sont un échec.
Les ONG rappellent que « la France a une responsabilité considérable dans la protection de l’anguille », car elle est « située au cœur de son aire de répartition », et réclament donc « des mesures de gestion plus strictes » de la part des pouvoirs publics. Elles alertent également sur l’existence d’un « trafic international extrêmement lucratif, où le prix au kilo peut atteindre 6 000 € », dans des pays comme la Chine ou le Japon, grands amateurs de civelles.
Que faire ? Tout d’abord, ne plus consommer ni d’anguille, ni surtout de civelle. Il est également possible de participer à la consultation publique ouverte jusqu’au vendredi 24 octobre, portant sur le projet d’arrêté ministériel de réduction du quota de pêche de civelles (1). Les volumes passeraient de 65 tonnes (équivalent à 220 millions de civelles) sur la campagne 2024-2025, à 55 tonnes pour 2025-2026 puis 43 tonnes en 2026-2027. Insuffisant pour les associations qui réclament un arrêt total de la pêche pendant plusieurs années, afin de laisser les populations se rétablir.
À l’instar du saumon, l’anguille vit en eau salée ou en eau douce, selon sa phase de développement. Son cycle de vie comporte trois étapes :

Elsa Casalegno
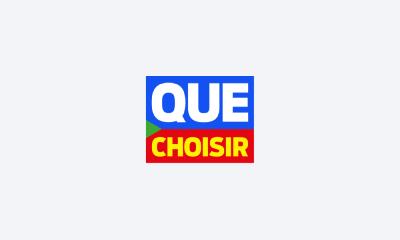


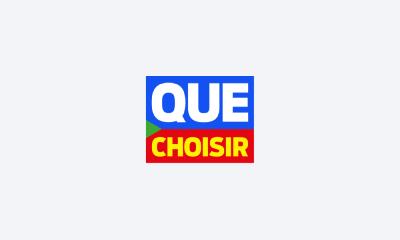

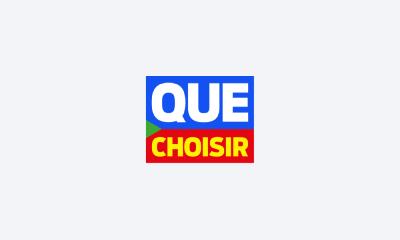
La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus
