
par Fabrice Pouliquen

par Fabrice Pouliquen
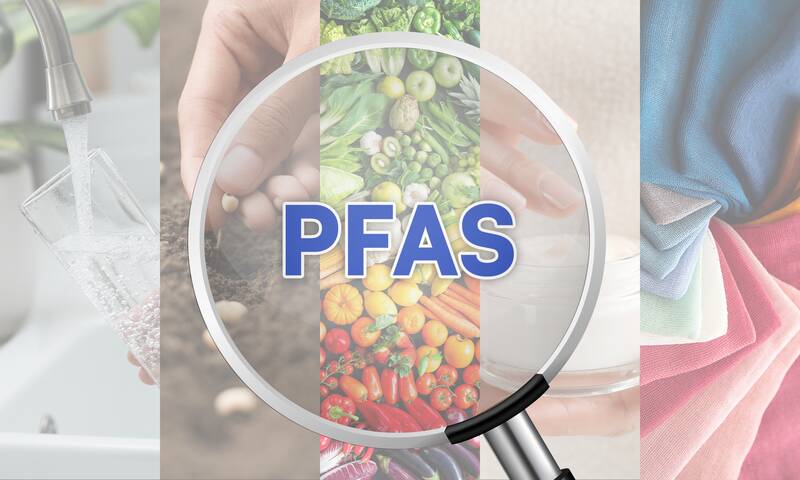
L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a publié deux rapports sur les polluants éternels. Le premier dresse un bilan des niveaux de concentration de ces substances dans les différents milieux d’exposition. Partant de ce constat, le second donne des recommandations pour renforcer les dispositifs de surveillance de ces PFAS dans les eaux… mais pas seulement.
Dans l’eau, l’alimentation, l’air, le sol, les poussières… L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) publie un état des lieux de la contamination aux PFAS en France, ainsi que des recommandations sur les évolutions à apporter aux dispositifs actuels de surveillance.
Vous avez sûrement déjà croisé cet acronyme « PFAS », pour composés per- et poly-fluoroalkylés, ces dernières années. Il désigne une vaste famille de 10 000 composés chimiques utilisés dans de nombreuses applications industrielles et produits de consommation courante. Leur point commun est d’avoir une liaison carbone-fluor très stable qui les rend très persistants dans l’environnement. D’où leur surnom de « polluants éternels ». C’est d’autant plus inquiétant que plus la science s’y penche, plus elle trouve à ces substances des effets néfastes sur la santé.
Le premier rapport que vient de publier l’Anses vise à parfaire encore cette connaissance scientifique toujours très parcellaire sur les PFAS. Le premier s’est principalement attelé à dresser cet état des lieux de la contamination des PFAS en France. L’approche était double, explique Céline Druet, directrice adjointe à l’évaluation des risques à l’Anses : « Nous avons fait la revue littéraire de tous les articles et données scientifiques concernant la contamination aux PFAS, à la fois français mais aussi internationaux lorsque nous manquions de données. En parallèle, nous avons utilisé les bases de données des dispositifs de surveillance déjà actifs et ceux de projets de recherche. » Au total, l’Anses a ainsi travaillé sur près de 2 millions de données portant sur tous les « compartiments » d’exposition à ces polluants éternels. Des milieux aquatiques à l’exposition professionnelle, en passant par les eaux de boisson, l’alimentation mais aussi l’air, les poussières et les sols.
Premier constat : « 142 PFAS ont été recherchés au moins une fois dans l’un de ces compartiments, indique Céline Druet. Ça peut paraître peu comparé aux 10 000 substances qui composent cette famille PFAS, mais ça montre tout de même le travail croissant de recherche, de surveillance et de contrôles engagé ces dernières années sur les PFAS. » Ces données apparaissent très hétérogènes. Elles sont abondantes là où des exigences réglementaires sont déjà effectives ou sont en passe de l’être. C’est le cas concernant les eaux de surface et souterraines et, par extension, les eaux destinées à la consommation humaine (eau du robinet).
À partir de janvier, en application d’une directive européenne, les Agences régionales de santé devront notamment surveiller obligatoirement dans leurs contrôles des eaux destinées à la consommation humaine – dont celle du robinet – 20 PFAS jugés prioritaires à suivre par Bruxelles. Les données concernant ces 20 substances sont d’ores et déjà abondantes, constate l’Anses. « C’est déjà moins le cas dans l’alimentation, malgré l’existence de teneurs maximales à ne pas dépasser pour certains PFAS, reprend Céline Druet. En revanche, les données pour les compartiments "air, poussière et sols" sont rares, en partie du fait de l’absence de programme de surveillance réglementaire à ce jour dans ces milieux. » Le constat vaut également pour l’exposition professionnelle aux PFAS, en particulier des travailleurs dans les usines utilisant ces substances.
C’est la première recommandation de l’Anses : combler ces trous dans la raquette et « parfaire les connaissances scientifiques sur la façon dont ces PFAS peuvent passer d’un milieu à l’autre », complète Matthieu Schuler, directeur général délégué du pôle Science pour l’expertise de l’Anses.
À partir de cette photographie de la contamination aux PFAS établie dans le premier rapport, l’Anses propose une stratégie de surveillance sur 247 PFAS. C’est tout l’objet du second rapport publié ce mercredi qui distingue 3 types de surveillance évolutifs et adaptés à chaque compartiment. La plus drastique est la « surveillance pérenne », « basée sur les plans de surveillance nationaux existants » et que l’Anses réserve aux PFAS les plus préoccupants et récurrents. À titre d’exemple, les 20 PFAS qui seront intégrés dans le contrôle sanitaire de l’eau potable à partir de janvier 2026 feront ainsi l’objet d’une « surveillance pérenne » au sens où l’entend l’Anses.
Mais l’agence recommande d’aller plus loin, en ajoutant 5 autres substances aux 20 listées dans la directive européenne. Parmi elles figure l’acide trifluoroacétique, plus connu sous le nom de TFA et qui fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause : ce PFAS, issu notamment de la dégradation du flufénacet, un pesticide très utilisé en agriculture et récemment classé comme perturbateur endocrinien par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), n’est toujours pas réglementé à ce jour. Pourtant, il est régulièrement retrouvé, et parfois à des concentrations préoccupantes, dans les analyses d’eaux naturelles et d’eaux potables lancées par des ONG environnementales ou encore par Que Choisir dans une étude de fin janvier (avec Générations futures). « Le TFA a été intégré parce qu’il répond à des enjeux de santé publique. Il a une forte occurrence essentiellement dans l’eau, et en plus certaines études ont révélé qu’il se retrouvait également dans le sang humain », justifie Nawel Bemrah, évaluatrice des risques sanitaires à l’Anses.
Dans l’alimentation, l’Anses recommande également un net renforcement de la surveillance de ces PFAS. Dans ce compartiment, seuls 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFHxS et PFNA) sont aujourd’hui réglementés à l’échelle européenne et seulement dans certaines familles d’aliments (œufs, poissons, crustacés, viandes). « Il n’y a pas non plus à ce jour de surveillance pérenne obligatoire », précisent Céline Druet et Nawel Bemrah. L’agence préconise de mettre sous ce régime une vingtaine de ces polluants éternels et d’élargir le spectre des aliments contrôlés aux céréales, fruits et légumes, miel, sucre ou encore alimentation infantile.
Reste à savoir quels échos auront ces recommandations auprès des autorités sanitaires françaises. L’Anses n’est pas la première instance à pousser pour un suivi renforcé des PFAS, notamment dans les eaux de boisson. En décembre 2024, pour les eaux destinées à la consommation humaine, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) préconisait déjà d’appliquer des seuils plus protecteurs des consommateurs que celui de la directive européenne. Cette dernière instaurait, pour la somme des concentrations de 20 PFAS réglementés, une limite de qualité à 100 nanogrammes par litre (ng/l) à ne pas dépasser dans les eaux de boisson. Le HCSP recommandait, en plus, d’établir une limite plus basse encore, à 20 ng/l, pour la somme des 4 PFAS dont la dangerosité est clairement établie (le PFOA, le PFOS, le PFNA et le PFHxS).
Matthieu Schuler, directeur général délégué du pôle Science pour l’expertise de l’Anses, invite à voir ces deux nouveaux rapports de l’Anses sur la surveillance des PFAS comme un axe de travail complémentaire aux restrictions progressives de l’utilisation des PFAS. Certaines de ces substances sont d’ores et déjà interdites ou restreintes (avec des dérogations limitées à certaines applications) au niveau international en raison de leur dangerosité avérée : le PFOS depuis 2009, le PFOA en 2020 et le PFHxS en 2022.
De nouvelles restrictions sont dans les tuyaux. En France notamment, où une loi adoptée en février dernier interdira dès 2026 les produits contenants des PFAS, quels qu’ils soient, dans les secteurs des cosmétiques, des farts (revêtements de ski), des vêtements et chaussures, avec un élargissement à tous les textiles d’ici 2030. Au sein de l’Union européenne, quatre États membres (Allemagne, Danemark, Pays-Bas et Suède) ainsi que la Norvège portent également une proposition de « restriction universelle » interdisant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’ensemble des PFAS (environ 10 000) dans l’Union européenne. Cette proposition est en cours d’examen par l’Agence européenne des produits chimiques (Echa). Elle devrait terminer ses travaux courant 2026, permettant à la Commission européenne de présenter dans la foulée un texte final comme elle s’y est engagée.
Cette restriction des PFAS reste un long cheminement jamais à l’abri de coups de rabot sur l’ambition. Dernier exemple en date : dans son examen de la proposition de « restriction universelle » des PFAS, l’Echa a ainsi décidé de laisser de côté 8 secteurs dans lesquels elle aurait pu s’appliquer sur les 14 étudiés initialement, provoquant la colère d’ONG environnementales.

Fabrice Pouliquen






La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus
