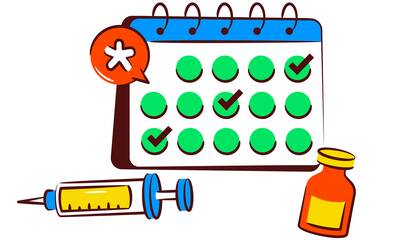par Anne-Laure Lebrun
Prévention de la bronchioliteL’imbroglio continue

Alors que la nouvelle campagne de prévention contre la bronchiolite infantile a démarré, l’accès aux traitements contre le virus en cause demeure marqué par des inégalités. Les pédiatres s’interrogent, par ailleurs, sur sa disponibilité à long terme dans les maternités.
La nouvelle campagne de prévention contre la bronchiolite pour l’année 2025-2026 a officiellement débuté le 1er septembre. Largement provoquée par le virus respiratoire syncytial (VRS), la bronchiolite est la première cause d’hospitalisation chez les enfants de moins de 12 mois. Chaque année, elle engendre plus de 100 000 visites aux urgences et 50 000 hospitalisations, perturbant profondément les services de pédiatrie. L’arrivée de traitements préventifs était, de ce fait, très attendue.
Cette année encore, la campagne s’appuie sur la vaccination des femmes enceintes par l’Abrysvo mais surtout le Beyfortus (nirsévimab), un anticorps monoclonal dirigé contre le VRS administré aux jeunes enfants. Il ne s’agit pas d’un vaccin mais d’un traitement de prévention. Mais comme l’an dernier, son remboursement varie entre l’hôpital et la ville, instaurant une situation d’inégalité pour les familles les plus précaires.
Qui est éligible à ce traitement préventif ?
Le Beyfortus est destiné aux nourrissons lors de leur première exposition au virus. Les enfants nés à partir du 1er septembre 2025 peuvent recevoir une dose en maternité ou, en rattrapage, en ville, jusqu’à la fin de la campagne début 2026. De même, les enfants nés entre le 1er février 2025 et le 31 août 2025 peuvent être immunisés en ville. Un récent arrêté a, par ailleurs, étendu son remboursement aux enfants qui demeurent vulnérables, notamment en raison de pathologies cardiorespiratoires, lors de leur 2e saison d'exposition VRS, et ce jusqu’à leurs 24 mois.
Cette année, comme l’an dernier, environ 600 000 doses de Beyfortus seront mises à disposition. Lors de la campagne 2024-2025, 352 000 nourrissons ont été immunisés, dont plus de deux tiers en maternité. Un bilan qui montre une forte adhésion à cette campagne, veut croire le ministère. Il montre aussi que de nombreux enfants nés en dehors de la campagne n’ont pas bénéficié de la protection de l’anticorps. Et pour un nombre non négligeable, les raisons sont économiques.
Comment est-il pris en charge ?
Le Beyfortus est entièrement pris en charge s’il est administré à la maternité, mais seulement remboursé à 30 % s’il est prescrit dans un cabinet de ville, par un pédiatre, un généraliste, une sage-femme ou une infirmière libérale.
Cette différence résulte de l’avis d’octobre 2024 de la Haute Autorité de santé (HAS) qui a jugé que son service médical rendu était « modéré ». En clair, elle a estimé que l’anticorps n’était pas assez efficace pour être mieux remboursé notamment lorsque celui-ci est comparé à un très vieux médicament, le Synagis. Une décision difficile à comprendre pour la communauté médicale. « Comparer avec le Synagis est une réflexion totalement désuète, car il est désormais remplacé par le Beyfortus, qui s’administre en une seule injection efficace pour tous les enfants, alors que le Synagis nécessite 6 injections à l’hôpital et ne concerne que les enfants prématurés », rétorque le Pr Naïm Ouldali, du service de Pédiatrie générale - Maladies Infectieuses - Médecine interne pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré (AP-HP). Mais alors pourquoi rembourser le Beyfortus à 100 % en maternité alors que la HAS le juge peu utile ? Interrogée, la Direction générale de la santé (DGS) botte en touche.
Cet imbroglio, dont seule l’administration française a le secret, provoque, de facto, une inégalité d’accès aux soins pour les familles les plus vulnérables. L’an dernier, cette injustice avait été signalée par les sociétés savantes de pédiatrie après avoir été alertées par des familles incapables de payer le reste à charge d’environ 300 € (sur 401,80 €) qu’une minorité de mutuelles ne rembourse pas ou partiellement. Des familles n’ayant, par ailleurs, pas recours ou ne pouvant pas prétendre au dispositif de l’aide médicale d’État (AME) ou la complémentaire santé solidaire (CSS). Ce remboursement insuffisant a aussi conduit les départements à ne pas acquérir de doses pour approvisionner les centres de protection maternelle et infantile. « Or, les enfants de familles précaires sont plus exposés au VRS et à ses séquelles ; il est donc crucial qu’ils bénéficient du nirsévimab », s’alarme le Dr Andreas Werner, président de l’Association française de pédiatrie ambulatoire (Afpa).
Enfin, les pédiatres s’interrogent sur sa disponibilité à long terme en maternité. En raison de l’avis de la HAS, le Beyfortus ne peut pas être inscrit sur la liste en sus, et ne peut donc pas être compris dans le prix du séjour en maternité ou facturé en sus des prestations d’hospitalisation. Pour cette raison, en 2025, un dispositif exceptionnel a été mis en place pour permettre aux hôpitaux de facturer le Beyfortus à l’État. « Des travaux sont en cours sur les modalités de financement pour 2026 », a précisé la DGS. « Ce dispositif sera-t-il pérenne ou devra-t-il être reconduit tous les ans ? Cette absence de visibilité est difficilement comprise par les praticiens, alors même que les preuves d’efficacité sont là. La France a été le premier pays au monde à proposer ce traitement à tous les enfants, sera-t-elle le premier à mettre fin à ces campagnes intégralement gratuites pour la population ? », s’inquiète le Pr Ouldali.
Quelle est l’efficacité de ce médicament préventif ?
La littérature scientifique démontre, chez tous les enfants, qu’une dose unique de nirsévimab réduit de plus de 80 % les passages aux urgences et le risque d’hospitalisation 6 mois après l’injection. Le risque d’admission en réanimation est aussi divisé par 5. Une réduction des infections respiratoires basses prises en charge en ambulatoire ainsi qu’une baisse de plus de 20 % des otites, et une efficacité de plus de 80 % sur les otites à VRS – ce dernier étant la première cause d’otite chez le nourrisson – est aussi observée.
Anne-Laure Lebrun
Lire aussi