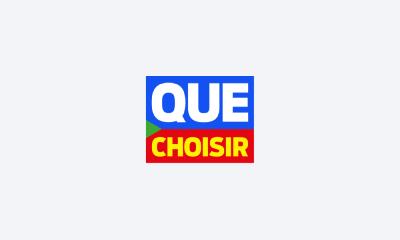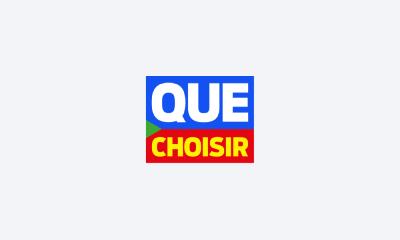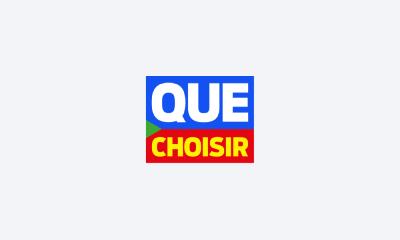par Emmanuel Eslin
JusticeQuels sont vos droits lors d’un litige avec un avocat ?

Basée sur la confiance, la relation qu’un client entretient avec un avocat peut se compliquer. Certains clients peuvent alors se trouver démunis pour faire valoir leurs droits face à un avocat. L’UFC-Que Choisir fait le point en 6 questions.
1. Mon avocat est injoignable. Peut-il me laisser sans nouvelles ?
Non Un avocat doit vous tenir informé de l’avancement de votre dossier. Cette information doit être fournie régulièrement et en temps utile.
L’information à chaque étape du dossier
Ayant été mandaté pour vous représenter, votre avocat doit vous rendre compte de la manière dont il exerce sa mission. Ainsi, il doit s’assurer que ce qu’il écrit correspond aux directives que vous lui avez fournies, notamment lorsqu’il rédige une assignation ou qu’il répond à des conclusions, dans la mesure où vos instructions ne nuisent pas à votre dossier. De même, il doit vous tenir informé des communications provenant du tribunal ou de la partie adverse.
Toutefois, comme votre avocat a aussi des devoirs envers ses autres clients, sa réponse à votre sollicitation peut ne pas être immédiate. En effet, la réglementation ne fixe aucun délai.
Le mode de contact à privilégier
Si vous avez besoin de réponses ou d’éclaircissements de sa part, contactez-le de préférence par écrit (courriel, courrier simple, SMS…). Vous garderez ainsi la trace de vos démarches.
En l’absence de réponse à vos démarches orales et écrites, adressez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de vous tenir informé de l’évolution de votre dossier sous un délai raisonnable (15 jours, 8 jours en cas d’urgence par exemple).
Vos recours
Vous pouvez solliciter le médiateur de la consommation de la profession d’avocat qui tentera de mettre fin à cette situation à l’amiable.
Une action en responsabilité peut être engagée devant le tribunal judiciaire, si vous subissez un préjudice en raison des manquements de votre avocat (conseil non fourni, action prescrite…).
Enfin, sachez que vous pouvez, à tout moment, changer d’avocat et confier la défense de vos intérêts à un autre professionnel plus réactif.
Les principes essentiels de la déontologie de la profession d’avocat
L’avocat a prêté un serment qui l’engage à exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Il doit également se comporter avec honneur, loyauté, et respecter les principes d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Vis-à-vis de ses clients, il doit faire preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. De plus, il est astreint au secret professionnel qui est absolu, général et illimité dans le temps.
2. Je doute que les honoraires facturés par mon avocat correspondent au travail effectué. Sont-ils contestables ?
Oui Vous pouvez contester la facture présentée par votre avocat si son montant vous paraît excessif au regard de la mission confiée ou s’il ne correspond pas à ce qui avait été convenu entre vous.
L’obligation d’information sur les tarifs
Avant son intervention dans une affaire, l’avocat doit vous renseigner sur les modalités de détermination des honoraires (forfait, temps passé, etc.). Il doit aussi vous informer, dès le début et tout au long de votre relation d’affaires, de l’évolution prévisible de leur montant. Ces tarifs doivent être affichés de manière visible et lisible, dans son lieu d’exercice et sur son site Internet.
La convention d’honoraires
L’avocat est libre de fixer ses tarifs. Sauf exceptions (urgence, force majeure ou aide juridictionnelle totale), il est tenu de vous remettre une convention d’honoraires. Lorsqu’elle est signée par les deux parties, ses prévisions s’imposent tant à l’avocat qu’à son client. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La facture doit correspondre aux dispositions de la convention d’honoraires et détailler les prestations effectivement réalisées par l’avocat.
→ Lire aussi Honoraires d’avocat - La justice attaquée… en justice
Vos recours
Si tel n’est pas le cas, ou s’il vous semble qu’il a surestimé le temps consacré à votre dossier, il est possible de contester certaines sommes.
En cas de désaccord persistant après un courrier de contestation, vous pouvez solliciter le médiateur de la consommation de la profession d’avocat ou le bâtonnier de l’ordre des avocats. Alors que le premier intervient exclusivement à l’amiable, le second exerce une fonction juridictionnelle et ses décisions sont susceptibles de recours devant le premier président de la cour d’appel.
L’honoraire de résultat
L’honoraire de résultat est une somme ou un pourcentage que l’avocat perçoit sur les gains obtenus par le client au tribunal en cas de succès de la procédure. Il est convenu dès le départ dans la convention d’honoraires ou ultérieurement si vous en êtes d’accord. La pratique est courante et légale, mais l’honoraire de résultat doit être complémentaire d’un honoraire déterminé en fonction d’autres critères (temps passé, forfait, etc.). En effet, la rémunération de l’avocat ne peut dépendre entièrement de l’issue du procès.
→ Lire aussi Lettre type - Contestation d’honoraires d’avocat
3. Mon avocat m’adresse une relance pour une facture alors que mon affaire est terminée depuis plus de 2 ans. Dois-je la lui régler ?
Non La prescription met fin au droit de l’avocat de réclamer le paiement de la dette. Le délai de prescription de l’action en recouvrement d’une créance d’un avocat envers un client consommateur est de 2 ans à compter de la fin de sa mission.
Le point de départ du délai
La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, c’est-à-dire quand la mission de l’avocat est effectivement terminée. En soi, le prononcé de la décision n’a pas pour effet de mettre fin au mandat qu’il a reçu de vous. La date de rédaction ou celle de réception de la facture ne constituent pas non plus des points de départ du délai. En fonction des situations, cela peut être la date où un avocat a été déchargé d’un dossier ou la date d’exécution d’un jugement.
Les événements modifiant la durée de la prescription
Attention, s’il est en principe de 2 ans, le délai de prescription peut, par exemple, être interrompu par la reconnaissance de la dette par le client ou par la saisine d’un tribunal. Il recommence alors à courir entièrement à partir de cet événement.
La prescription peut également être suspendue lorsque les parties décident d’essayer de résoudre leur litige à l’amiable (médiation, conciliation, etc.). La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. En revanche, l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception par l’avocat à son client en vue du paiement de la dette n’a pas d’effet sur le cours de la prescription.
La prise en compte de la prescription
Dès lors que votre avocat vous réclame un paiement au-delà de ce délai, opposez-lui la prescription. Surtout, n’oubliez pas de le faire devant le juge en cas de procès. Celui-ci n’examinera cet argument que si vous le lui demandez.
Bon à savoir Pour les cas où l’avocat réclame une somme à un client qui n’est pas un consommateur (une société, un syndicat des copropriétaires, un commerçant…), la prescription de l’action est de 5 ans.
4. Mon avocat refuse d’inclure dans ses conclusions les arguments que je souhaite faire valoir lors du procès. Puis-je l’y obliger ?
Oui En tant que mandataire, l’avocat doit réaliser la mission que vous lui avez confiée. Mais il peut s’opposer à certaines demandes.
L’avocat, mandataire de son client
Votre avocat vous représente. Il est en quelque sorte votre porte-voix.
Au cours du procès, il doit en principe suivre les instructions que vous lui fournissez et utiliser les arguments que vous souhaitez voir employés afin de défendre vos intérêts.
Les instructions « inutiles ou anormales »
Si votre avocat estime que les arguments que vous souhaitez invoquer sont inutiles, inopérants, contre-productifs, voire illégaux, il doit vous l’expliquer dans le cadre de l’exercice de son obligation de conseil et d’information. Si vous maintenez néanmoins votre demande de voir certains arguments utilisés, il ne pourra pas forcément vous donner satisfaction. En effet, votre avocat est susceptible d’engager ses responsabilités contractuelle et disciplinaire si son intervention est contraire à vos intérêts ou à la déontologie de la profession.
En effet, il est tenu de respecter les règles déontologiques de la profession d’avocat qui l’obligent à être loyal à son client et à faire preuve de probité à l’égard de tous (partie adverse, juge, tiers…). Elles lui imposent également de faire preuve de prudence lors de l’application des instructions du client.
Le règlement d’un désaccord
Lorsque vous estimez le refus de votre avocat injustifié, vous pouvez engager sa responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire si vous subissez un préjudice (qui peut être la perte d’une chance).
Un avocat qui n’est pas en mesure de trouver un accord avec son client sur la ligne de défense à tenir doit en principe se décharger de l’affaire. Vous pouvez également prendre l’initiative de changer d’avocat, cependant vous risquez de vous retrouver dans la même situation.
L’avocat rédacteur d’acte
Représenter son client en justice n’est pas le seul travail de l’avocat. Au titre de ses autres missions, il doit également suivre les instructions de son client qui ne sont pas anormales. Ainsi, il peut rédiger des actes juridiques (contrats, statuts, règlements intérieurs, protocoles d’accord ou de transaction, cessions de fonds de commerce ou de parts sociales…). Il doit s’assurer de la pleine efficacité de l’acte rédigé et répond de ses fautes.
5. J’ai l’impression que mon avocat ne défend pas mes intérêts. Puis-je en changer ?
Oui Vous êtes libre de changer d’avocat à tout moment, quel que soit l’avancement de la procédure, notamment en cas de perte de confiance ou si vous n’êtes pas satisfait de son travail. Mais changer d’avocat nécessite de procéder par étapes.
La communication avec les deux professionnels
Vous pouvez informer vous-même votre avocat de votre décision et lui demander la restitution des pièces de votre dossier avant d’en contacter un nouveau. Mais vous pouvez aussi consulter un autre avocat directement et lui confier la défense de vos intérêts. Dans tous les cas, votre nouvel avocat prendra contact, par écrit, avec son prédécesseur afin de l’en informer et d’obtenir, si nécessaire, les éléments de votre dossier. Par ailleurs, il doit vérifier auprès de lui si ses diligences ont été payées et, si ce n’est pas le cas, vous inciter à régulariser la situation, sans prendre parti.
L’information du tribunal et de la partie adverse
Votre nouvel avocat doit informer le tribunal et la partie adverse qu’il est dorénavant votre nouveau conseil. Si une audience est proche et que votre nouvel avocat n’a pas eu le temps de prendre connaissance du dossier, il peut solliciter du juge un renvoi de l’audience à une date ultérieure, ce qui peut rallonger la procédure.
La résolution des litiges avec le prédécesseur
Votre nouvel avocat ne s’implique pas dans la rupture entre votre ancien avocat et vous. Par exemple, il ne peut pas plaider contre son ancien confrère sans accord préalable du bâtonnier. De son côté, l’ancien avocat ne peut en aucun cas refuser de transmettre votre dossier et les documents qu’il contient sous prétexte qu’il n’a pas encore été payé. Il ne dispose d’aucun droit de rétention. Mais il a droit au paiement de ses honoraires dans la mesure du travail accompli. En revanche, le bâtonnier (pour les questions d’honoraires) et le tribunal judiciaire (en matière de responsabilité) peuvent tout à fait être saisis d’un litige entre un avocat et son ancien client.
Un avocat peut aussi renoncer à défendre un client
Un avocat peut tout à fait se désengager de la défense d’un client pour différentes raisons (comportement du client, conflit d’intérêts, désaccord sur la stratégie, honoraires impayés…). Il doit le faire de manière à préserver le plus possible les intérêts de son client (l’en informer suffisamment longtemps avant une audience pour qu’il ait le temps de lui trouver un successeur, par exemple). Il ne doit pas non plus le faire dans des conditions vexatoires, car sa responsabilité professionnelle pourrait être engagée en cas de rupture trop brutale.
6. J’ai perdu en justice car mon avocat a commis une erreur de procédure. Puis-je lui demander une indemnisation ?
Oui Vous pouvez être indemnisé de votre préjudice si vous prouvez qu’il résulte d’une faute commise par votre avocat.
La responsabilité de l’avocat
Votre avocat doit répondre des fautes qu’il a commises (erreur de procédure, mauvais conseil, etc.) dans le cadre d’une affaire. Sa responsabilité, fondée sur le contrat qui vous lie, vise à réparer les conséquences que vous subissez du fait de sa faute. La réparation prend en général la forme de dommages-intérêts, c’est-à-dire d’une somme d’argent venant compenser votre préjudice.
Vous devez donc prouver à la fois sa faute, la nature de votre préjudice et le fait que ce dernier est lié à cette erreur de procédure. Votre avocat est tenu d’une obligation de moyen (et non de résultat) : il doit tout faire pour gagner le procès, mais ne peut pas vous en garantir l’issue.
L’évaluation du préjudice
Mesurer le préjudice subi n’est pas toujours évident, car l’issue d’un procès est par nature aléatoire. Il est impossible de savoir à l’avance si un client va gagner, car une procédure peut toujours prendre une direction inattendue. C’est pourquoi l’évaluation du préjudice est appréciée en fonction du critère de la perte de chance de gagner un procès, c’est-à-dire une estimation raisonnable des chances de gagner le procès, en fonction des décisions antérieurement rendues dans des affaires similaires. La perte de chance subie par le client est laissée à l’appréciation des juges.
La compétence du tribunal judiciaire
Ce type de litige ne relève pas de la compétence du bâtonnier. Aussi, faute d’arrangement amiable, il vous faudra saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation de son cabinet ou de votre lieu de résidence. Vous devez agir dans un délai de 5 ans à compter du jour où votre dommage s’est révélé (le jour où le tribunal a définitivement rejeté vos demandes, par exemple). Si vous souhaitez être assisté, mais qu’aucun avocat ne souhaite vous représenter contre un confrère, demandez au bâtonnier d’en désigner un.
L’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’avocat
Tout avocat doit être couvert par une assurance pour les fautes qu’il peut commettre dans le cadre de sa profession. Il peut la souscrire pour son compte, mais certains barreaux ont négocié avec des assureurs des contrats collectifs couvrant automatiquement l’ensemble des avocats inscrits au tableau, c'est-à-dire ayant le droit d'exercer la profession d'avocat. Les avocats doivent également être assurés pour les fonds des clients qu’ils sont amenés à recevoir.
Le saviez-vous ?
Le médiateur de la consommation de la profession d’avocat
Avant de s’adresser à la justice, les consommateurs ayant un litige avec leur avocat peuvent solliciter le médiateur de la consommation de la profession d’avocat. Sauf exceptions, la saisine d’un médiateur ou d’un conciliateur de justice est même obligatoire pour les litiges jusqu’à 5 000 €. C’est une autorité indépendante désignée par le Conseil national des barreaux (CNB). Il peut être saisi après qu’une réclamation écrite préalable a été adressée à l’avocat concerné. Le particulier doit introduire sa demande auprès du médiateur dans un délai maximum de 1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel. Le médiateur est compétent en matière d’honoraires comme de responsabilité. Les échanges sont strictement confidentiels. Sa décision n’a pas de caractère obligatoire pour les parties. Le délai de réponse est en principe de 90 jours.
Une profession réglementée : l’ordre des avocats
Chaque avocat doit être inscrit auprès d’un barreau, un ordre professionnel local, afin de pouvoir pratiquer son métier. Il y a un barreau auprès de chaque tribunal judiciaire. Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre, présidé par un bâtonnier, dont les membres sont élus pour 3 ans. Les barreaux sont regroupés au sein du Conseil national des barreaux qui a édicté le Règlement intérieur national de la profession d’avocat. Ce règlement reprend l’ensemble des règles déontologiques de la profession, notamment les devoirs de l’avocat envers son client. L’avocat est tenu de s’y conformer, faute de quoi il pourrait être poursuivi disciplinairement devant les juridictions du barreau dont il dépend. Les sanctions peuvent aller du simple avertissement à la radiation du barreau.
Le choix de l’avocat rémunéré par l’aide juridictionnelle
Si vos revenus sont faibles, vous pourriez être éligible à l’aide juridictionnelle. Il s’agit d’une prise en charge par l’État de vos frais d’avocat, qui peut être totale ou partielle. Lorsqu’une aide vous est accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, deux possibilités s’offrent à vous :
- soit vous connaissez un avocat acceptant d’être rémunéré par l’État à qui vous pouvez proposer votre dossier ;
- soit vous laissez le bâtonnier de l’ordre vous en attribuer un.
Ce choix peut même avoir lieu avant que le bureau d’aide juridictionnelle ait rendu une décision vous accordant l’aide juridictionnelle.
La rémunération de l’avocat commis d’office
Si vous ne trouvez pas d’avocat pour vous défendre, un avocat peut vous être attribué par le bâtonnier ou par un juge dans certaines procédures pénales, civiles ou administratives (garde à vue, mesures d’assistance éducative, protection des majeurs, par exemple). Vous ne pouvez pas le choisir, il s’agit d’un avocat commis d’office. Il est rémunéré par vos soins ou pris en charge par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle lorsqu’elle vous est accordée.
Dans certaines procédures (comparution immédiate, déferrement à un juge d’instruction…), il est rémunéré directement par l’État, qui va ensuite vous en demander remboursement, sauf si vous êtes éligible à l’aide juridictionnelle.
L’avocat dans le cadre de l’assurance de protection juridique
Pour défendre vos droits, vous bénéficiez peut-être d’une assurance de protection juridique vous permettant de recourir à un avocat. Comme le contrat doit vous le rappeler, vous avez le libre choix de l’avocat. L’assureur ne peut vous en attribuer un que si vous lui en faites préalablement la demande écrite. Une fois désigné, il est votre mandataire et n’a aucun compte à rendre à l’assureur quant à la tenue du dossier. C’est le client qui signe la convention d’honoraires avec l’avocat. Par ailleurs, dès qu’un avocat intervient au soutien de votre adversaire, votre assurance de protection juridique doit vous permettre de bénéficier également de l’assistance de l’un de ses confrères. Dès lors qu’un avocat intervient, les juristes des sociétés de protection juridique cessent de gérer le litige.
La procédure de « taxation d’honoraires » devant le bâtonnier
Le bâtonnier peut être saisi, par un client ou par un avocat, de toute contestation relative aux honoraires par lettre recommandée avec avis de réception.
Après avoir recueilli les observations de l’avocat et du client, il doit rendre sa décision dans les 4 mois, délai qu’il peut prolonger une fois.
Sa décision peut devenir contraignante si elle est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête de l’avocat ou du client consommateur. Elle peut faire l’objet d’un recours par courrier recommandé avec avis de réception devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 1 mois à compter de sa notification.
Les bons réflexes en vue du premier rendez-vous
Sur les frais et honoraires
- Vérifiez le caractère gratuit ou payant du premier rendez-vous.
- Faites-vous expliquer le mode de calcul des honoraires et demandez une estimation du coût total de la procédure.
- Si vous y êtes éligible, demandez à l’avocat s’il accepte d’être rémunéré par l’aide juridictionnelle.
- En cas d’honoraire de résultat, vérifiez son mode de détermination et négociez-en le montant s’il vous paraît excessif.
- Vérifiez à quels autres coûts vous pourriez être exposé : frais d’expertise judiciaire, frais irrépétibles et dépens d’instances, actes d’huissier, frais de postulation (rémunération d’un avocat qui effectue des actes de procédure pour votre compte lorsque votre avocat n’est pas compétent pour les faire), etc.
- Lisez la convention d’honoraires afin de vérifier qu’elle correspond bien aux explications fournies avant de la signer.
Sur la compétence de l’avocat
- Demandez-lui si votre dossier concerne un domaine du droit où il intervient régulièrement, voire s’il dispose d’un certificat de spécialité en la matière.
- Demandez-lui également s’il compte suivre personnellement le dossier ou en confier la charge à un collaborateur, notamment le jour de l’audience de plaidoirie.
Sur votre dossier en lui-même
- Demandez à l’avocat d’estimer les chances de succès de l’affaire, sa durée prévisible et les voies de recours éventuelles.
- Vérifiez quelles sont les pièces indispensables à la constitution du dossier.
- Interrogez-le sur les chances d’une négociation amiable si la situation s’y prête.
- Faites-vous préciser qu’en cas de succès de la procédure, le jugement serait effectivement susceptible d’être exécuté (solvabilité de la partie adverse…).
Emmanuel Eslin
Service d’information juridique
Lire aussi