
par Boris Cassel

par Boris Cassel

L’Agence de la transition écologique (Ademe) a analysé la consommation énergétique d’une centaine de ménages ayant récemment remplacé leur chaudière au gaz ou au fioul par une pompe à chaleur (PAC). Son verdict est sans appel : les économies sur les dépenses de chauffage sont spectaculaires. L’intérêt est, cependant, moins évident pour la production d’eau chaude. Pour autant, puisque l’installation d’une PAC coûte plus de 15 000 € sans aide financière, l’opération prend de 6 à 17 ans avant d’être plus intéressante financièrement que de rester au chauffage au gaz.
Présentées par les fabricants comme des produits capables de faire fondre nos factures énergétiques sans réchauffer l’atmosphère, les pompes à chaleur (PAC) tiennent-elles réellement leurs promesses ? Cette technologie utilise des calories captées dans une source d’énergie renouvelable (air, eau, terre) pour chauffer un logement équipé de radiateurs à eau (PAC air/eau), d’un chauffage au sol ou de climatiseurs fixes (PAC air/air). Il existe, au moins, deux façons de s’y prendre lorsque l’on souhaite savoir si elle est efficace. La première consiste à tester plusieurs modèles en laboratoire. C’est ce que fait, depuis plusieurs années, Que Choisir, avec les pompes à chaleur air/eau et celles dites air/air.
L’autre option consiste à suivre, sur un temps long, la consommation énergétique de logements équipés. C’est cette dernière méthode qui a été utilisée par l’Agence de la transition écologique (Ademe) pour les besoins d’une étude récemment publiée. L’agence a scruté, en 2023 et 2024, la consommation énergétique de 100 maisons individuelles, dont 90 équipées d’une PAC air/eau et une dizaine de PAC géothermiques. Ces ménages ont, pour la plupart, troqué leur chaudière au gaz et au fioul pour ce dispositif au cours des trois dernières années. Cette étude inédite apporte des éclairages intéressants sur les questions que se posent souvent les futurs acquéreurs de pompe à chaleur.
Oui, sans aucun doute. Pour mesurer le rendement d’un chauffage, on s’appuie généralement sur son coefficient de performance (COP, aussi appelé SCOP lorsqu’on le mesure sur toute une saison) qui rapporte l’énergie produite à l’énergie consommée. En clair, il s’agit de comprendre combien de kWh sont consommés (et facturés…) pour produire 1 kW de chaleur. « Plus le COP est élevé, plus la machine produit de la chaleur efficacement », résume l’Ademe. On considère, généralement, que le COP des radiateurs électriques et des chauffages est proche de l’unité. Les résultats de nos tests ont prouvé, qu’en laboratoire, les pompes à chaleur pouvaient afficher de biens meilleurs rendements. L’étude de l’Ademe vient confirmer cette efficacité. En moyenne, les « COP saisonniers mesurés » sont de « 2,9 pour les PAC air/eau et 4,3 pour les PAC eau/eau ». Autrement dit, les pompes à chaleur consomment trois à quatre fois moins d’énergie qu’un radiateur électrique. Certaines pompes à chaleur sont dites « double service » car elles apportent, en plus, l’eau chaude sanitaire (douche, vaisselle, etc.). Les résultats, dans ce domaine, sont bien moins intéressants, voire « décevants », avec 46 % des pompes à chaleur ayant un COP inférieur à 2 pour la production d’eau chaude sanitaire. « La PAC air/eau est probablement légèrement moins performante que les chauffe-eaux thermodynamiques individuels », commente l’Ademe.
Puisqu’elles puisent des calories dans l’air extérieur, ce type de chauffage ne serait efficace que… lorsqu’il fait chaud. C’est, en tout cas, l’une des critiques récurrentes contre cette technologie. Certes, l’Ademe note que les PAC installées dans le sud de la France sont 30 % plus efficaces que celles installées dans le nord du pays. Pour autant, ces dernières restent tout à fait efficientes sur l’ensemble du territoire, y compris lorsque le thermomètre plonge. « Les machines restent performantes en cas de vague de froid : un COP moyen de 2 a été mesuré le 20 janvier 2024 à une température moyenne de -4 °C », relève l’Ademe.
Non. Nos tests avaient déjà pointé de gros écarts sur certains modèles entre le rendement promis et celui mesuré. L’étude de l’Ademe le confirme. « Les SCOP fabricant sont en moyenne supérieurs aux valeurs mesurées dans 85 % des cas », pointe l’Ademe. Avec une « surcote », en moyenne, de 1,29. Le rendement réel est donc bien en deçà des promesses marketing.
Non. L’Agence de la transition écologique a constaté une « grande variabilité des résultats entre les logements » ainsi que des « performances parfois spectaculaires avec des COP saisonniers supérieurs à 4 pour certaines PAC air/eau et à 7 pour une PAC eau/eau ». Pour autant, lors de la présentation de cette étude, l’Ademe indiquait aussi qu’un tiers des PAC avaient des résultats « un peu moins bons avec des COP inférieurs à 1,5 ». L’étude montre que les modalités d’installation (obstacles limitant la circulation de l’air, etc.), son réglage (ajustement de la température de l’eau circulant dans le circuit en fonction des conditions extérieures dites « loi d’eau ») et la configuration du système de chauffage jouent pour beaucoup dans l’efficacité de la pompe à chaleur. Ainsi, si on en a la possibilité, notamment si vous êtes en train de construire votre maison, mieux vaut privilégier un chauffage au sol. « Les installations sur plancher bénéficient d’une performance en moyenne 30 % supérieure à celles sur radiateurs », explique l’Ademe. Et surtout, selon cette dernière, le rendement d’un tiers des pompes à chaleur pourrait être amélioré, pour peu qu’elles soient réglées correctement.
« Le coût moyen des travaux s’élève à 15 287 € TTC », explique l’Ademe. Attention, il ne s’agit que d’une moyenne. Certains participants de cette étude ont acheté leur machine 10 000 €, quand d’autres ont été facturés 25 914 €. Il est possible d’alléger la facture en ayant recours aux aides publiques. Au final, « le reste à charge moyen s’élève à 9 961 € TTC ».
Résumons. À température de chauffage identique, une PAC consomme beaucoup moins d’énergie qu’une chaudière au gaz. Mais elle coûte bien plus cher à l’achat (plus du double). Alors, en combien de temps l’achat d’une pompe à chaleur est-il amorti ? Il y a deux cas de figure.
Dans la première situation, la chaudière au gaz du logement a flanché. La question qui se présente alors au ménage est simple : faut-il se contenter d’investir dans une nouvelle chaudière au gaz ou faire un effort financier supplémentaire pour s’équiper d’une pompe à chaleur ? Puisque, de toute façon, ce ménage devra investir dans un nouveau chauffage, c’est la question du surcoût engendré par le choix d’une PAC plutôt que d’une chaudière au gaz qui est sur la table. « L’ensemble des données de terrain recueillies permettent d’estimer que le surcoût du choix d’une PAC par rapport à une chaudière gaz est globalement amorti en deux ans après déduction des aides, et en six ans sans déduction, avec les coûts actuels de l’énergie », explique le rapport de l’Ademe. En clair, le ménage ne sera gagnant qu’après six ans de fonctionnement (voire deux ans s’il est éligible aux aides publiques).
Regardons le deuxième cas, celui d’une famille ayant une chaudière au gaz qui tourne toujours mais qui s’interroge sur l’intérêt de la déposer prématurément pour la remplacer par une PAC, dans le but de faire des économies ou d’émettre moins de CO2. Dans cette situation, le choix est simple : investir dans une PAC ou ne rien faire ? Le calcul tient donc compte du coût total de l’installation d’une pompe à chaleur. Et c’est une tout autre histoire… « Le temps de retour financier de remplacement d’une chaudière gaz qui fonctionne par une PAC vaut 9 ans en médiane (12 ans en moyenne) avec les aides. Sans les aides, ce temps de retour sur investissement monte à 14 ans en médiane (17 ans en moyenne) », souligne l’Ademe. Un temps long pendant lequel des pannes lourdes peuvent surgir. Alors, mieux vaut bien prendre le temps de mûrir cet investissement dans ce second cas et ne pas faire l’impasse sur d’autres pistes permettant d’économiser de l’énergie, comme une meilleure isolation du logement.

Boris Cassel

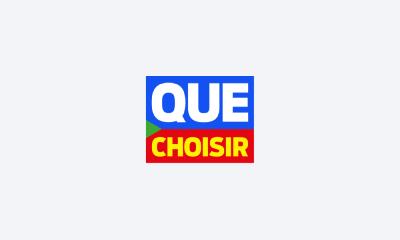




La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus
