
par Audrey Vaugrente

par Audrey Vaugrente
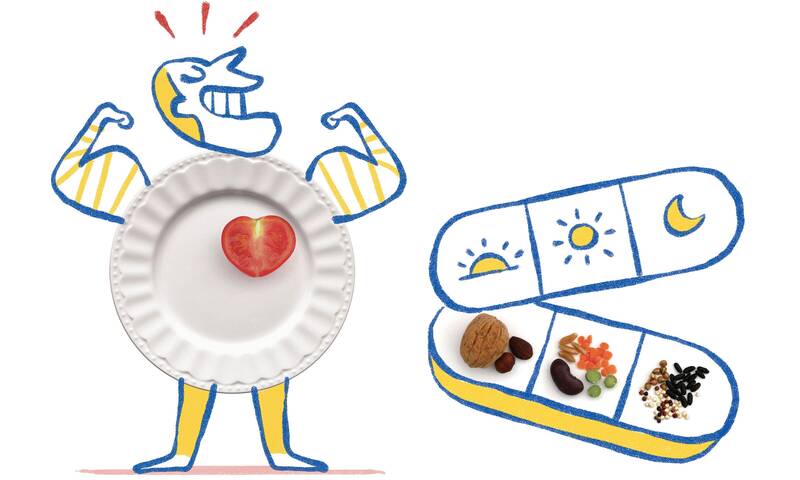
À condition d’être équilibré et varié, le « régime » alimentaire joue un rôle majeur pour notre santé. Adapté pour certaines maladies chroniques, il peut aussi agir comme un véritable traitement.
« Non merci, je suis au régime. » Ces mots sont souvent associés à une privation alimentaire, des restrictions caloriques, un souhait de perdre du poids et, il faut bien l’avouer, une certaine frustration. Malgré cette mauvaise réputation, le régime contribue pour une part importante à notre santé. Pas lorsqu’il est destiné à faire maigrir à des fins esthétiques, mais bien lorsqu’il désigne un ensemble d’habitudes alimentaires ! Il est même parfois un traitement à part entière de certaines maladies chroniques, comme le diabète de type 2 ou l’hypertension. Et cela sans exiger de sacrifices. Alors il est temps de se réconcilier avec ce mot.
La base d’une alimentation équilibrée et variée peut se résumer en 3V – vrai, végétal, varié – d’après des travaux menés par Anthony Fardet, chercheur à l’unité de nutrition humaine de l’université Clermont-Auvergne. « Ces critères correspondent à une alimentation comprenant peu d’aliments ultra-transformés, plus de végétaux et plus de variété dans les aliments consommés », explique-t-il. Et il est crucial de respecter ces trois composantes pour en tirer un bénéfice pour la santé. « Adhérer à ces 3V pourrait théoriquement prévenir 11 millions de décès prématurés par an », rapporte le chercheur. « C’est le socle d’une alimentation préventive et curative », confirme le Pr Sébastien Czernichow, chef du service de nutrition de l’hôpital européen Georges-Pompidou (Paris). Certains régimes alimentaires correspondent assez bien à cette règle.
De loin le plus étudié, et reconnu pour ses effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires, le régime méditerranéen correspond aux habitudes historiques de consommation longtemps retrouvées sur le pourtour de la Méditerranée – donc communes à plusieurs cultures. Il fait la part belle aux fruits et légumes, qui constituent la base de la pyramide alimentaire. Viennent ensuite les céréales, idéalement complètes, les légumineuses (pois chiches, lentilles, fèves…), puis, en moindre quantité, les oléagineux non salés (noix, noisettes, amandes…) et le poisson. À l’inverse, la viande rouge, la charcuterie, les aliments ultra-transformés et les sucres ajoutés se font plutôt rares. Tout ceci forme un cocktail parfait pour prévenir de nombreuses maladies. Cet effet préventif est particulièrement éprouvé contre les maladies cardiovasculaires, mais aussi contre le diabète de type 2. « Le bénéfice d’une modification du mode de vie a un effet bien démontré, souligne le Pr Czernichow. Même en situation de prédiabète, cela limite le risque d’évolution vers un diabète. » L’alimentation méditerranéenne aide aussi à prévenir l’hypertension artérielle, certains cancers ainsi que l’excès de cholestérol. Pour ne rien gâcher, elle permet une perte de poids allant de 4 à 6 kg, selon les études. Son point fort : elle est compatible avec les exigences alimentaires strictes de certaines maladies chroniques comme l’insuffisance cardiaque ou rénale.
Bon à savoir Le régime méditerranéen est une base qui permet de diminuer les marqueurs d’inflammation dans le sang (voir encadré "Alimentation anti-inflammatoire - Mythe ou réalité ?"), et ce même sans perdre de poids.
Adapté du régime méditerranéen, le régime Dash (pour dietary approaches to stop hypertension) a été présenté pour la première fois à un congrès de cardiologie en 1996 dans l’objectif de traiter l’hypertension. Il met l’accent sur les apports en certains nutriments associés à une moindre pression artérielle (potassium, magnésium, calcium, fibres, protéines) et sur la réduction du sodium – qui ne devrait pas dépasser 2 g par jour, soit 5 g de sel. Les légumes occupent la moitié de l’assiette, les aliments riches en sel sont écartés. Et les bénéfices sont au rendez-vous. L’impact maximal du régime Dash s’observe chez les personnes hypertendues qui consommaient beaucoup de sodium : on obtient alors une baisse de la pression systolique (le premier chiffre) de 11,5 mm Hg, que l’on perde du poids ou non. À la clé, une action durable, qui s’étend aux maladies cardiovasculaires, favorisées par l’hypertension.
Mais l’intérêt du régime Dash ne s’arrête pas là. Il permet aussi une réduction du poids, de l’indice de masse corporelle (IMC) et du LDL-cholestérol. À l’image du régime méditerranéen, et même sans souffrir d’hypertension, il est utile en prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et des maladies rénales chroniques.
Pas de viande ou de poisson mais des œufs et des produits laitiers en quantité raisonnable, et davantage de produits végétaux en particulier des légumineuses : voilà comment on peut résumer une alimentation végétarienne. Le régime végétarien classique exclut toute chair animale (viande, poisson, fruits de mer). Mais il y a débat. Les pesco-végétariens conservent tout de même le poisson et les fruits de mer, ce qui simplifie les apports en oméga 3 et offre une source de protéines supplémentaire. Les végans ou végétaliens, eux, excluent tout produit d’origine animale. Pas simple, donc !
S’orienter vers une alimentation végétarienne se traduit par une augmentation de la consommation de fibres, vitamines et minéraux et par un recul des graisses saturées, majoritairement d’origine animale. Cela fait baisser plusieurs facteurs de risque de maladies chroniques : poids, lipides sanguins, métabolisme du glucose, pression artérielle. Dans une certaine mesure, aller jusqu’à exclure tout produit animal peut avoir un intérêt. Une étude a comparé, chez 22 paires de jumeaux identiques, un régime omnivore à un régime végan. Au terme des 8 semaines d’expérience, ce dernier a permis une réduction du poids, des lipides et de la glycémie à jeun. Mais qu’en est-il des maladies elles-mêmes ? Les végétariens développent moins de maladies cardiovasculaires ou rénales, de diabète de type 2, mais aussi de certains cancers (prostate, système digestif, sein).
Le régime végétarien est toutefois un peu plus exigeant que le méditerranéen et le Dash : il faut veiller à bien équilibrer ses apports alimentaires afin d’éviter toute carence. En effet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire a récemment souligné que les végétariens présentent souvent une insuffisance en fer, iode, vitamines B12 et D ainsi qu’un moins bon équilibre phosphates/calcium. En cas d’alimentation végane, la supplémentation en vitamine B12 est essentielle, car les plantes (les algues, par exemple) n’en fournissent qu’une quantité négligeable.
Autre point de vigilance particulière : ne pas remplacer les produits animaux bruts par des produits végétaux transformés, comme les steaks végétaux ou les galettes de céréales aromatisées. « Beaucoup de personnes végétariennes ou végétaliennes consomment une grande quantité d’aliments ultra-transformés, qui contreviennent aux bienfaits d’un régime riche en végétaux », indique ainsi Anthony Fardet.
Comment passer d’une alimentation déséquilibrée à un régime plus végétal et plus varié ? En s’y mettant progressivement pour ne pas brusquer notre organisme. « Il faut agir avec modération pour aller dans la durée », conseille le Pr Czernichow. Par exemple, remplacer les céréales raffinées par un équivalent complet ou semi-complet ou ajouter une poignée de noix à son alimentation quotidienne. Un moyen simple pour y arriver consiste aussi à faire les bons choix en supermarché. Ce n’est pas forcément plus cher, comme l’a montré en 2021 l’équipe d’Anthony Fardet (1) : au contraire, un caddie « 3V » coûtait 4,6 % moins cher sur un échantillon de 122 hypermarchés. « On peut s’en sortir avec des produits pas trop coûteux : légumes surgelés, pâtes alimentaires, lentilles sèches… », dit le chercheur. Le tout est de trouver l’articulation entre effort et routine. « Quand on doit pousser une voiture, c’est difficile au départ mais, une fois lancée, elle roule toute seule », illustre-t-il, lui qui a lui-même modifié ses habitudes alimentaires il y a une dizaine d’années.
Outre son effet préventif, un régime mieux équilibré et plus varié constitue un traitement de première ligne contre plusieurs maladies chroniques. Dans l’hypertension, le diabète de type 2 ou l’excès de cholestérol, avant même de parler de médicaments, des changements du mode de vie doivent être proposés. « Un suivi régulier par un diététicien ou un médecin nutritionniste est essentiel », ajoute le Pr Czernichow. C’est l’une des clés pour parvenir à changer durablement son alimentation et garder la motivation nécessaire.
Absorber uniquement de la soupe à tous les repas, cela semble aberrant, non ? C’est pourtant un régime souvent mis en avant pour perdre rapidement du poids. Tout aussi inventif, le régime « couleur » consiste à attribuer une couleur à chaque jour de la semaine. On n’ingère que des aliments qui y correspondent : tomate, fraise et bœuf pour le rouge, concombre, courgette et kiwi pour le vert, etc. Certains vont jusqu’à suggérer d’adapter l’alimentation au groupe sanguin, pour lequel des aliments seraient bénéfiques et d’autres toxiques. Seul effet possible de ces régimes, non validés par la communauté scientifique : engendrer des déséquilibres alimentaires, voire une prise de poids.
Dans d’autres cas, bien moins universels, le régime sera plus strict et adapté à la prise en charge de certaines maladies. Il est alors un traitement à part entière, permettant de limiter l’aggravation de la maladie ou d’en éviter les manifestations ! Mais il peut être à l’origine de déséquilibres alimentaires. Un suivi régulier par le médecin s’avère donc essentiel.
Le sel est un élément à surveiller étroitement en cas d’insuffisance cardiaque en raison du sodium qu’il contient. Les médecins ne prescrivent plus de régime strictement sans sel, mais appellent à le limiter fortement : 4 g par jour, voire 1 à 2 g en cas d’hospitalisation. Ce n’est pas rien puisqu’on en consomme plutôt 6 à 8 g par jour en moyenne ! Cette chasse au sodium s’explique par son rôle majeur dans l’aggravation de la maladie. En excès, il entraîne une rétention d’eau par les reins, augmentant ainsi le volume sanguin. Cette surcharge en eau (hypervolémie) distend les cavités du cœur, réduisant peu à peu la force de contraction du muscle cardiaque, et accentue divers symptômes comme l’œdème et les difficultés respiratoires. Le sodium favorise aussi la constriction des vaisseaux sanguins et diminue l’efficacité des diurétiques, couramment prescrits contre l’insuffisance cardiaque.
Éviter certains aliments permet de limiter l’apport quotidien en sodium : charcuterie, plats cuisinés, sauces préparées, olives, cornichons, fromage, pain, etc. Cuisiner soi-même la majorité de ses repas est la meilleure solution pour parvenir à manger moins salé. Les substituts au sel sont plutôt déconseillés, en particulier ceux à base de sel de potassium, susceptibles d’entraîner une surdose sévère de potassium (hyperkaliémie).
Bon à savoir Un régime pauvre en sel est aussi conseillé en cas de poussée d’hypertension artérielle et de prééclampsie, une complication de la grossesse pouvant être grave.
En cas d’insuffisance rénale, la situation est plus complexe. Pour compenser le dysfonctionnement des reins et limiter l’aggravation de la maladie rénale, il est nécessaire d’assurer des apports équilibrés en potassium, phosphore, protéines et calcium. La clé étant d’en consommer ni trop, ni trop peu. L’excès de potassium est susceptible de provoquer des crampes et des complications mortelles. Les apports doivent donc être limités, surtout en cas de dialyse. Certains aliments très riches en potassium (avocat, arachides, pistache…) sont plutôt à éviter. Pour le phosphore, c’est la même chose : faute d’être éliminé par les reins, il s’accumule dans le sang, entraînant démangeaisons, douleurs articulaires et calcification des artères. Viandes, poissons et fromages, fruits à coques et légumes secs sont donc à surveiller, tout comme les additifs phosphorés (E338, E339…). Les apports en protéines sont à adapter et fractionner selon les conseils du médecin, car elles se dégradent en urée. Tous ces ajustements étant susceptibles de créer des déséquilibres alimentaires, un accompagnement par un médecin ou un diététicien est nécessaire.
Bon à savoir En cas de dialyse, les apports en eau sont eux aussi limités pour éviter la prise de poids liée à l’accumulation d’eau dans l’organisme.
Dans certaines situations, l’éviction alimentaire est la seule solution. C’est le cas pour les allergies alimentaires, les intolérances au lactose ou au gluten (maladie cœliaque), qui provoquent des réactions sévères. Cette décision est à prendre après le diagnostic du médecin, et avec un suivi lorsque les restrictions sont nombreuses. Celui-ci peut conclure à une « simple » sensibilité au gluten ou au lactose, entraînant un inconfort réel (ballonnements, troubles gastriques…). En réduire la consommation est parfois suffisant. Moins stricte, cette mesure sera mieux vécue.
L’exclusion peut aussi diminuer certains troubles digestifs, en particulier le syndrome de l’intestin irritable. On parle alors de régime pauvre en Fodmaps (pour fermentable oligo‑, di‑, mono-saccharides and polyols). Cet acronyme désigne les sucres peu digestibles, qui fermentent au contact des bactéries du côlon et qui sont soupçonnés d’être à l’origine de symptômes digestifs (douleurs, gaz). On les trouve dans de très nombreux aliments, aussi divers que les fruits (pomme, pêche), les légumes (poireau, chou-fleur), les légumineuses, le blé ou les produits laitiers riches en lactose. Toutefois, l’éviction provoque de sérieux déséquilibres alimentaires. En pratique, il faut éliminer l’ensemble des aliments riches en Fodmaps de son alimentation pendant 4 semaines, puis les réintroduire peu à peu afin d’identifier ceux qui sont tolérés ou non.
Riche en graisses, pauvre en glucides et modéré en protéines : c’est le régime cétogène. Il a été développé contre les épilepsies réfractaires aux médicaments (qui concernent 30 % des patients). Il permet de modifier la source de production d’énergie par l’organisme. En effet, le corps utilise normalement le glucose venant des glucides (pâtes, pain, riz, aliments sucrés…). Si on ne lui en fournit pas assez, il exploite les lipides pour produire des corps cétogènes – d’où le nom de ce régime. Mais on ignore encore comment ce mécanisme aide à limiter les crises convulsives.
Le régime cétogène ne remplace pas les médicaments et son efficacité n’est pas garantie : c’est donc une solution de dernier recours. Très contraignant sur le plan alimentaire, il doit rester un traitement prescrit par un médecin en raison de ses risques. En effet, il est riche en graisses saturées (plutôt néfastes pour le système cardiovasculaire), favorise les déficiences en nutriments car il limite les fruits et légumes, et entraîne constipation et mauvaise haleine. Mais surtout, il peut induire des complications au niveau du foie ou des reins, qui sont sursollicités. Pourtant, il est souvent présenté comme un régime permettant de perdre du poids. Ce n’est pas raisonnable. Difficile à tenir dans la durée, il s’accompagne très souvent d’une reprise rapide des kilos perdus.
Très populaire auprès des personnes souffrant de maladies chroniques inflammatoires (rhumatismes, endométriose, celles affectant l’intestin…), le régime anti-inflammatoire est-il vraiment efficace ? Sur le papier, il est intéressant. Il a les mêmes bases que le régime méditerranéen. Riche en végétaux, oméga 3, fibres et antioxydants, c’est une source abondante de nutriments ayant une action anti-inflammatoire. Mieux encore, des études montrent que ce type d’alimentation réduit des marqueurs d’inflammation chronique, comme la protéine C-réactive. Mais « ce n’est pas parce qu’on agit sur un marqueur d’inflammation qu’on agit sur les symptômes », souligne le Pr Sébastien Czernichow, coauteur de Arthrose, arthrite : je me soigne en mangeant (2024, éd. Solar).
Suivre les principes de l’alimentation anti-inflammatoire s’avère de manière générale bénéfique, avec une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et de certains cancers. Mais lorsqu’on s’intéresse à son impact sur des maladies à composante inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde ou arthrose), les résultats sont moins certains et bien plus modestes. « Ces modifications diététiques ne doivent en aucun cas remplacer les médicaments, indique le Pr Czernichow. Elles apportent un réel bénéfice en plus des autres traitements, mais aucun essai clinique n’a encore prouvé que la diététique seule permettait de les éviter en cas de rhumatisme inflammatoire chronique. » À tester, donc, mais sans en attendre des miracles.
(1) Renewable Agriculture and Food Systems, Fardet et al., 04/08/21.

Audrey Vaugrente




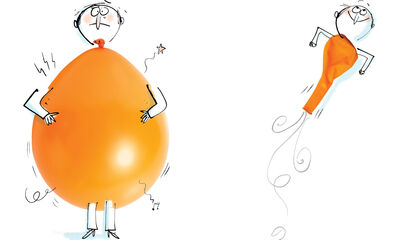

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus
