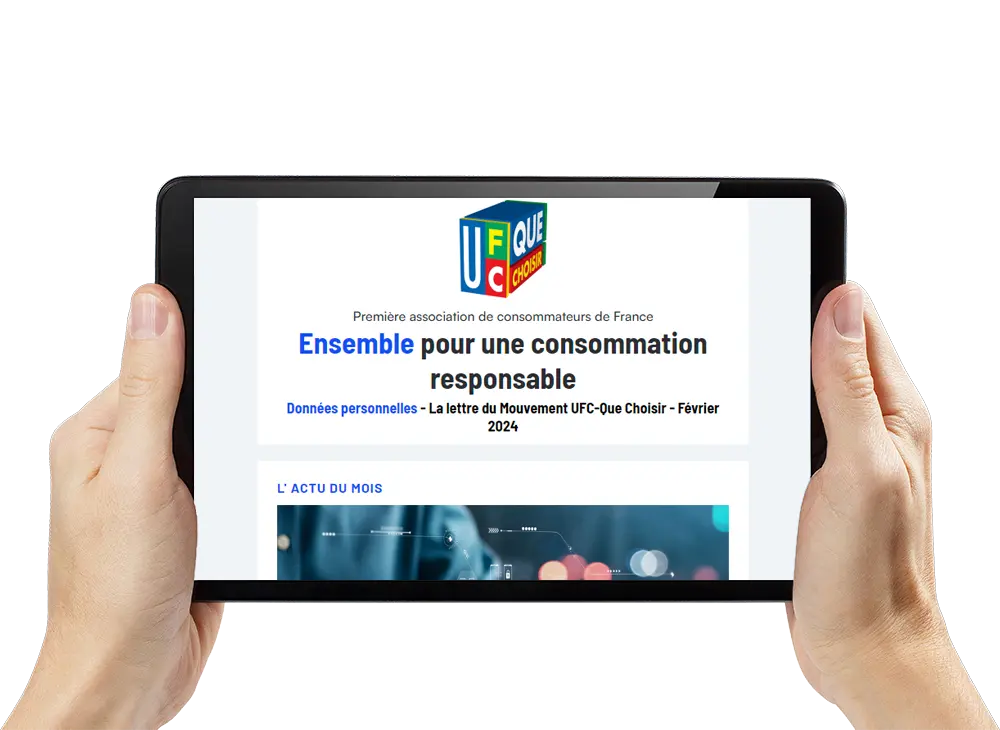Dossier Label - Appellation
Logo AB, AOP, IGP, Label Rouge, Pêche durable, logos de consommateurs, labels textiles... Il existe aujourd'hui une infinité de labels. Mais tous ne se valent pas. Si certains sont une véritable garantie pour le consommateur, d'autres ne sont rien de plus que des allégations marketing. Comment les différencier ? Que Choisir vous aide à décrypter les principaux labels et appellations.