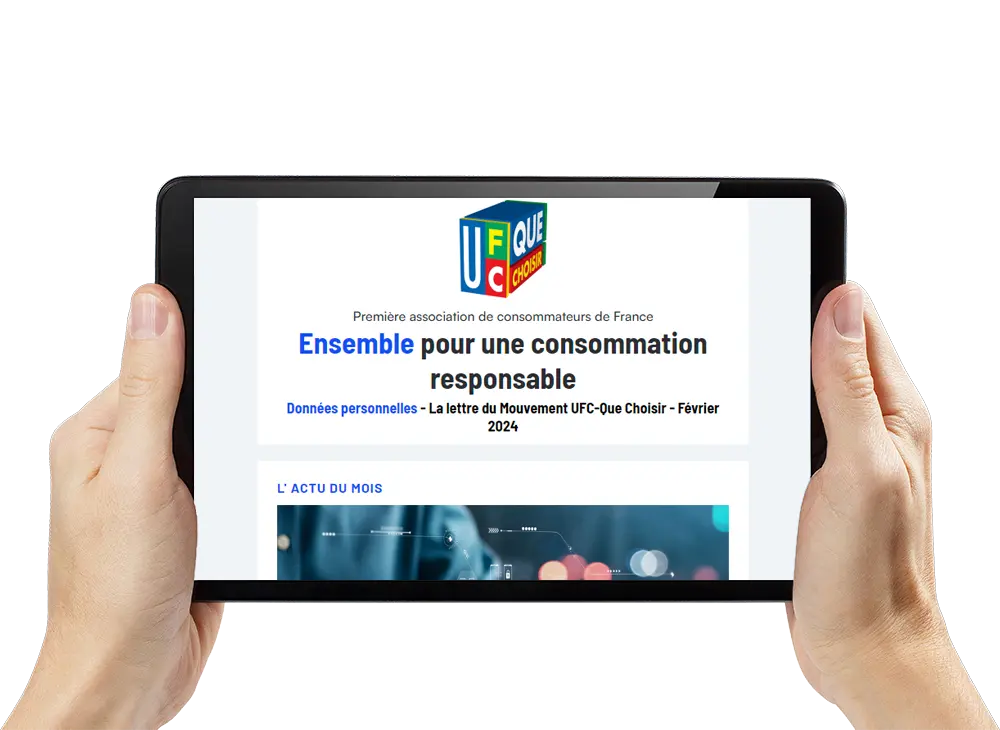Fontaines à eau dans les lieux publics
À l’approche de l’été, une enquête nationale menée par l’UFC-Que Choisir et No Plastic In My Sea alerte sur l’absence…

Lettre ouverte au Gouvernement et aux eurodéputé.e.s
Le 30 juin prochain à Bruxelles, les institutions européennes se réuniront pour le dernier cycle de négociations visant…

Fast fashion
Shein, place de marché en ligne basée en Chine, est aujourd’hui la première plateforme dans le secteur de la mode en…

Scandale Nestlé Waters
Malgré les révélations scandaleuses des derniers jours, aucune mesure n’a été prise contre le géant Nestlé pour garantir…

Eau potable
Lancée en 2021, l’action de groupe intentée par l’UFC-Que Choisir contre la Cise Réunion vient d’aboutir à une décision…
Bagage à main
Aujourd’hui, l’UFC-Que Choisir et la CLCV pour la France et 14 autres organisations membres du Bureau Européen des…
Airbags Takata
Après une première plainte déposée en janvier dernier contre Citroën et la sphère Stellantis, et alors qu’un nouveau…
#StopAuxSubstancesNocives
Face à la persistance de substances nocives dans les produits du quotidien, l’UFC-Que Choisir renforce son engagement…
Scandales « SFAM »
Les audiences du procès « SFAM/INDEXIA » qui se sont tenues à l’automne 2024 et ont abouti à la condamnation des…
Rénovation énergétique
Alors que la France compte 4,2 millions de passoires énergétiques, l’UFC-Que Choisir publie une étude démontrant…
Révision des droits des passagers aériens
Alors que l’Europe a réouvert la révision du règlement européen traitant des droits des passagers aériens en cas de…
PPL Garot
Retour à l’Assemblée nationale pour la proposition de loi (PPL) transpartisane portée par le député Guillaume Garot.…
Acquisition d’un véhicule électrique
Alors que le secteur des transports est le plus émetteur de gaz à effet de serre, une nouvelle étude de l’UFC-Que…
Lettre ouverte pour le maintien de la notice papier dans les boîtes de médicaments
Nous, associations de consommateurs et d’usagers du système de santé, exprimons notre plus vive inquiétude face à la…
Achat groupé granulés de bois
Après l’électricité, le gaz et le fioul, l’UFC-Que Choisir, via sa filiale, la SAS Que Choisir, lance en avril 2025 un…
Frais de découverts bancaires
Chaque année, des millions de Français ayant recours à un découvert paient des frais exorbitants. L’UFC-Que Choisir…
Déserts médicaux
L’UFC-Que Choisir et l’ACCDM (Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux) saluent avec une très grande…
Glyphosate
Le Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest, Foodwatch, France Parkinson et l’UFC-Que Choisir se…
Démarchage à domicile dans le secteur des travaux de rénovation énergétique
Une analyse effectuée par l’UFC-Que Choisir d’un millier de litiges individuels traités par ses associations locales…
Députés, soyez à la hauteur
Après plus de dix ans de mobilisation contre la fracture sanitaire, l’UFC-Que Choisir se félicite que l’Assemblée…
Voiture électrique
L’UFC-Que Choisir dévoile aujourd’hui une nouvelle étude (1) qui confirme que la voiture électrique est une alternative…
Scandale sanitaire
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’UFC-Que Choisir, s’appuyant sur une enquête édifiante…
Stop au démarchage téléphonique
Ce jeudi 6 mars, l’Assemblée nationale devra prendre une décision claire : mettre enfin un terme définitif au fléau du…
Électricité
L’UFC-Que Choisir publie une étude exclusive révélant l’impact catastrophique de la nouvelle régulation du nucléaire,…
Alimentation, Agriculture
Les organisations portant le recours contre le label dit de « Haute Valeur Environnementale » prennent acte de la…
Parlementaires
À la veille de la journée d’initiative parlementaire du groupe Écologiste, l’UFC-Que Choisir appelle les députés à…
Saint-Valentin empoisonnée
Offrir des fleurs pour la Saint-Valentin, un geste d’amour ? Pas si sûr. Derrière ces bouquets se cache un danger…
Marge minimale de 10 % garantie à la grande distribution
L’effet inflationniste du relèvement du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires est aujourd’hui largement…
Inégalités d’accès aux soins essentiels
Face à un modèle de financement de notre système de santé à bout de souffle, l’UFC-Que Choisir dénonce des inégalités…
Polluants éternels dans l’eau du robinet
L’UFC-Que Choisir et Générations Futures dévoilent aujourd’hui une étude préoccupante sur la présence massive des PFAS,…
Airbags Takata
Face aux zones d’ombre persistantes dans la gestion plus que chaotique du scandale des airbags Takata, l’UFC-Que Choisir…
Transport aérien
L’UFC-Que Choisir et Ryanair sont parvenues à un accord sur l’indemnisation de nombreux passagers et la mise en place,…
Tarifs réglementés de vente d’électricité en sursis
Les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) sont toujours considérés comme une exception aux règles de…
Procès SFAM
Au terme de sept années d’un combat sans répit pour l’UFC-Que Choisir, et après plus de deux mois de délibéré, la 31ème…
Pesticides
La Cour d’appel de Versailles a confirmé ce 29 novembre l’annulation de cinq chartes en Centre-Val de Loire (Loiret,…
Plus de 10 millions de Français sans alternatives à la voiture !
Alors que les transports sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre et que le recours aux transports en commun…